L’Arche de Noé – dialogue
Comme une cabane qui irait sur l’eau / Dialogue entre Silvia Costa, metteuse en scène, Marielle Macé, universitaire, enseignante à l’EHESS et autrice de Nos cabanes, et Simon Hatab, dramaturge
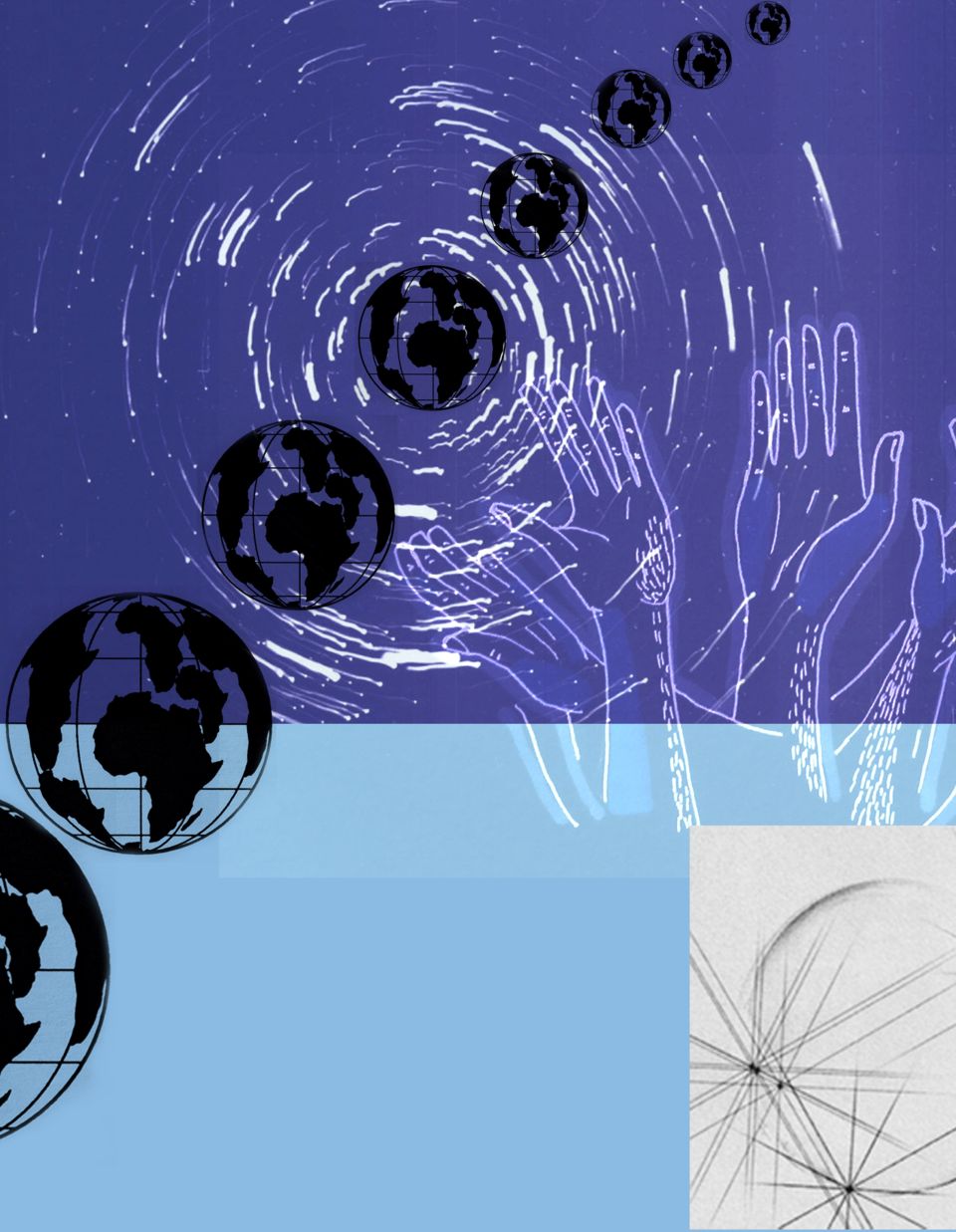
Simon Hatab : Inspiré par le mythe du déluge, L’Arche de Noé de Benjamin Britten présente un monde en crise, un monde menacé par la montée des eaux : des thèmes qui trouvent un écho évident dans le dérèglement climatique que nous vivons actuellement. Marielle Macé, nous avions à cœur de mener ce dialogue avec vous car votre pensée fait partie de celles qui nous ont accompagnés pendant le processus de création du spectacle. Je pense notamment à la réflexion politique que vous développez dans votre livre Nos cabanes (Éditions Verdier, 2019) , où vous explorez ces habitats précaires, construits comme des espaces de résistance : résistance à la violence d’un système économique dont les dommages collatéraux semblent être aujourd’hui la destruction de la planète, du vivant et des communs mais aussi des liens qui nous permettent de faire société. En préambule à cet entretien, j’aimerais vous demander de nous raconter la genèse de cette pensée. Comment en êtes-vous venue à élaborer cette réflexion ?
Marielle Macé : Je crois que cette réflexion est née de l’entremêlement de trois fils. Il y a d’abord eu un fil intellectuel, qui tient à mon travail. Je suis chercheuse au CNRS, et ma dynamique de recherche m’a conduite à travailler au croisement de la littérature et des sciences humaines sur la question des « formes de vie » : comment vit-on, ici, ailleurs ? comment vivre autrement ? qu’est-ce qui nous fait espérer si fort d’autres manières de vivre ? Lorsque j’ai considéré qu’il me fallait moi aussi entrer dans la bataille, j’en suis venue à la question écologique. Et j’ai voulu réfléchir à la manière dont toute une génération essaie de s’y prendre autrement avec la vie, notamment avec le sol, l’habitat, le travail… à la manière dont cette génération tente – notamment à travers les Zones À Défendre – de changer courageusement, puissamment et joyeusement les manières de vivre.
Le deuxième fil est biographique. Je viens d’une famille d’agriculteurs, dans la région de Nantes, particulièrement abîmée par la culture intensive. Sur ce territoire un mot a toujours résonné très fort, qui donne son nom à beaucoup de hameaux ou de lieux-dits dans la région : « la noue », qui désigne en fait une mini-zone humide, un fossé végétalisé où l’eau de pluie peut s'infiltrer, tout un savoir-faire et un savoir-vivre avec l’eau. Car une noue permet de préserver les sols en traitant l’eau de pluie non comme un déchet, vite conduit des fossés aux égouts, mais comme un bien, à protéger. Ce mot était une chance, car il en fait venir beaucoup d’autres, que vous entendez déjà — du côté des liens, des nœuds, des attachements, du collectif — et j’ai décidé d’avancer derrière lui comme un petit bateau derrière sa voile.
Il faut ajouter un troisième fil qui concerne mon rapport quotidien à la jeunesse, en tant que professeure à l’EHESS. J’ai écrit ce livre en signe de gratitude envers une génération qui se voit signifier depuis le début qu’il n’y aura pas de place pour elle : pas de travail, pas de logements, pas de soins… Cette génération me semble refuser ce monde où il faudrait se trouver une place et la défendre contre les autres. Elle exige un monde différent, un monde de liens. C’est la génération de mes étudiants que j’observe, que j’admire souvent. Et c’est cette admiration qui m’a autorisée à intituler mon livre Nos cabanes alors que je n’en ai moi-même pas construit : parce que je trouve que ce qu’ils font aujourd’hui nous regarde tous.
Silvia Costa : Lorsque j’ai lu ton livre, ce mot a attiré mon attention : on y entend le pronom pluriel nous mais aussi, en français, le verbe nouer…
Marielle Macé : Oui, c’est un tout petit mot, et un tout petit bout de terre, mais qui concentre des idées capitales. Il m’a semblé relier les territoires abîmés et les luttes actuelles. Pendant toute mon enfance, j’ai entendu ce mot, mais la pratique qu’il désignait avait disparu. Je l’ai retrouvé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il a résonné comme une invitation à renouer avec le territoire, à reprendre tout un fil de pensée autour des espaces collectifs, à réfléchir à ce besoin de nous rassembler pour inventer d’autres manières de cultiver, de transmettre, de vivre, d’aimer. Dans certains cas, ce mot noue s’écrit d’ailleurs aussi noé, et cela nous ramène à l’arche. Il me semble que l’arche de Noé n’est pas seulement un refuge ou un abri mais aussi un lieu ou rassembler les forces pour se donner la possibilité d’un futur.
Simon Hatab : Silvia, cette question – qu’est-ce que l’arche ? – est au cœur de ton travail, qui interroge le sens de l’œuvre et ses symboles… Et j’ai l’impression que la réponse reste ouverte : on ne sait jamais ce qu’est réellement cette arche. Lorsque la voix de Dieu ordonne à Noé de la construire, tout le monde s’active avec un marteau, une hache, une scie… Mais lorsqu’il est temps d’embarquer, la forme de l’arche apparaît plus mystérieuse. Elle semble davantage être un passage, un trou noir, comme une plongée dans l’inconnu…
Silvia Costa : En condensant le mythe biblique, Britten en a réduit la polysémie tout en faisant parfois des choix mystérieux. Lorsque j’ai commencé à réfléchir à cet opéra avec des enfants, la première question que je me suis posée concernait effectivement la représentation de cette arche : je ne comprenais pas comment elle pouvait aller sur l’eau et naviguer avec tous les animaux entassés à l’intérieur. Alors je me suis dit qu’elle ne devait pas se réduire à un bateau, qu’elle symbolisait autre chose. L’arche est un projet autour duquel collabore toute une communauté : cette communauté voulue par Britten compte quelques adultes et beaucoup d’enfants. Elle s’élargit vers le public, conformément au souhait utopique du compositeur qui voulait écrire une œuvre que tout le monde pourrait chanter. L’arche, c’est ce théâtre dans lequel on entre et l’on s’assied pour partager ensemble une heure de nos vies.
Simon Hatab : Marielle, l’idée d'une arche symbolique, immatérielle rappelle l’un des aspects les plus intéressants de votre livre : les cabanes précaires dont vous parlez sont faites avec du bois et de la tôle, mais ce sont aussi des cabanes d’idées et de mots qui nous permettent de nous relier les uns aux autres…
Marielle Macé : Oui, et suite à notre dernière discussion, j’ai relu le passage du déluge dans la Genèse. J’ai été surprise. Ce n’est pas exactement un bateau qui est construit. Je crois que le mot désigne un coffre, un coffre-fort, un cercueil même. Et j’ai été frappée par la référence répétée au goudron, à l’asphalte : Dieu ordonne de badigeonner la construction de bois avec du goudron, au-dehors comme au-dedans, pour la protéger de l’eau. Cela m’a rappelé le jardin que l’artiste Derek Jarman a installé à la fin de sa vie sur la côte du Kent. Il se savait malade du Sida, et il a acheté un cottage à quelques dizaines de mètres de la côte, au bord d’une mer houleuse. Il a recouvert sa maison de goudron, comme une grande cabane toute noire, et a consacré les dernières années de sa vie à faire pousser des plantes dans cet environnement inhospitalier, sur cette terre aride. Il a aussi peuplé ce jardin de sculptures construites à partir de galets et de pieux de bois flotté qu’il ramassait sur la plage. Par leurs formes, ces sculptures rappellent des tombes, des stèles, au milieu des fleurs, comme s’il s’agissait de persister à affirmer la vie dans ce un lieu qui ressemble aussi à un cimetière…
Simon Hatab : Les enfants jouent un rôle essentiel dans le spectacle : au début, la communauté est dirigée par Noé qui tient son autorité de la voix de Dieu. Mais peu à peu, on voit les enfants prendre les choses en main. Il y a un passage de relais entre les générations…
Silvia Costa : Oui, je ressens le malaise et la souffrance dont parle Marielle à propos de la jeune génération, de sa précarité, de ses difficultés à entrer dans un monde qui la refuse. L’une des particularités de notre spectacle est de mettre en scène des enfants, de leur donner ce rôle, cette responsabilité : la responsabilité d’agir, de guider le spectacle, de tenir le gouvernail. Les adultes se tiennent à côté d’eux, conscients qu’il leur faut passer la main : les suivre, les écouter, les soutenir tout en les laissant être. Cette partie du spectacle, qui échappe à la fiction, compte beaucoup à mes yeux : je suis souvent désabusée par notre attitude à nous autres, adultes, lorsque nous pensons tout savoir et tout avoir fait au mieux. Je trouve qu’il y a une forme de fatalisme et de cynisme, de laisser-aller. Quand je vois les enfants, cette jeunesse qui est une pure énergie vitale, qui incarne le futur, l’avenir, je ressens une forme de responsabilité à lui laisser cet espace d’expression.
Marielle Macé : Ce que vous dites me rappelle un vers d’un poète que j’aime beaucoup – Stéphane Bouquet. Dans son recueil Vie commune (Éditions Champ Vallon, 2016) , il écrit qu’il ne faut pas seulement se sauver de la mort mais se sauver dans la vie : s’enfuir activement dans la vie, comme si c’était un lieu, courir vers elle pour se sauver. J’aime cette formulation.
Simon Hatab : Dans le spectacle, l’autorité de cette voix de Dieu ne va pas de soi
Silvia Costa : Il s’adresse à l’humanité mais sa voix a du mal à se faire entendre : elle a toujours un problème d’amplification. Elle est trop forte ou trop réverbérée. Il y a trop d’effets. Je crois que la solution ne peut pas venir d’en haut. Il ne faut pas attendre qu’on nous sauve : le projet est de nous sauver nous-même. Dans la Bible, le Christ demande au Ciel : “Pourquoi m’as-tu abandonné ?” Mais j’ai l’impression que cette phrase peut s’inverser, que c’est aussi l’humanité qui abandonne Dieu et le laisse à sa solitude et son ennui…
Simon Hatab : Notre société s’est progressivement laïcisée. Que peuvent nous apporter des mythes tels que le déluge qui nous semblent aujourd’hui de plus en plus lointains ?
Silvia Costa : Il me semble que ces mythes ne nous sont pas extérieurs. Le déluge, qui apparaît dans de nombreuses cultures, fait partie de notre construction culturelle. Le philosophe Ernesto De Martino écrit que les récits religieux ont pour fonction de nous donner la force de traverser les épreuves parce que leur fin est souvent positive. Ils nous redonnent espoir en nous permettant d’imaginer d’autres fins possibles. Après le déluge, la légende dit que Noé aurait planté un pied de vigne pour les générations futures. Bien sûr, ces légendes sont des armes à double tranchant : le mythe du déluge rejette précisément la montée des eaux au statut de mythe alors qu’elle est aujourd’hui très concrète. Mais je crois qu’aujourd’hui, nous devons trouver un moyen de nous réapproprier ces mythes, de les relire et de les recréer, de ne pas les abandonner aux religieux.
Marielle Macé : Peut-être que le mythe de l’arche de Noé, aujourd’hui, affirme moins un message qu’il ne nous pose une question : que voulons garder, préserver, transmettre ? Nous sommes requis à travers ce récit. C’est comme un rendez-vous avec l’avenir, avec la mémoire, avec le sens, que l’on est bien obligés d’honorer, un rendez-vous auquel on se doit d’aller même si l’on n’a rien à en dire, même si l’on n’en a pas envie.
Simon Hatab : Silvia, tu as dit un jour que, sur ces sujets, il était important de ne pas donner de réponse aux gens, que ce ne sont pas des problèmes qui peuvent se régler sur scène… De fait, lorsqu’on voit tes spectacles, on a effectivement l’impression que tu es plus intéressée par créer au plateau des imaginaires que par apporter des idées toute prêtes…
Silvia Costa : Je ne veux pas me mettre dans la position du Dieu de Noé qui dispense sa parole à l’humanité. Je ne vais pas dire aux gens ce qu’ils doivent penser. Une communauté est composée d’individus différents qui ont tous leurs propres opinions et c’est le dialogue qui permet de créer de nouvelles idées. Au théâtre, je dispose d’un plateau et les spectateurs acceptent de me donner de leur temps, un temps suspendu et inhabituel à notre époque. Alors je préfère l’utiliser pour poser des questions en laissant chacun cultiver sa différence.
Simon Hatab : Les espaces poétiques que tu ouvres me rappellent l’importance que tient la poésie dans votre réflexion, Marielle. Vous citiez tout à l’heure l’exemple du mot noue qui a initié et guidé votre réflexion, mot intraduisible car lié à la poétique même de la langue…
Marielle Macé : Oui, et si ne peut pas exactement traduire, c’est qu’on a besoin de toutes les langues. Concernant ma pratique de la poésie, vous aurez compris que je marche dans les pas de la langue, je m’appuie sur les chances qu’elle me donne pour y faire pousser de la vie. C’est ici aussi une question de transmission : nous « faisons avec » des états de langue qui nous sont légués, dont nous héritons, que nous recueillons et que l’on vient frotter aux circonstances du présent, pour prendre des nouvelles de nous-mêmes. Il me semble que c’est un peu la même chose dans votre démarche lorsque vous mettez en scène une œuvre du passé comme L’Arche de Noé : vous ne cherchez pas à gommer l’étrangeté de l'œuvre originale. Au contraire, vous allez à sa rencontre. Je pense notamment à la scène des femmes, de Madame Noé qui ne veut pas monter à bord de l’arche pour ne pas abandonner ses amies. À la première écoute, on peut avoir l’impression que c’est une scène anecdotique, secondaire, où il est question de vin et d’ébriété. Mais, par le travail que vous faites sur le geste, vous rendez à cette scène son importance et son mystère. Madame Noé refuse d'abandonner ses amies, et nous aussi il ne nous faut rien abandonner de ces œuvres du passé… Nous devons découvrir comment ces histoires nous parlent, justement dans ces endroits surprenants et bizarres.
Simon Hatab : Puisque nous parlons de la langue, parlons des autres langages qui sont représentés dans l'œuvre. L’opéra commence par la voix de Dieu qui annonce le déluge et se transmet à Noé. Mais par la suite, après le déluge, les mots se font plus rares, laissant place à d’autres langages : les gestes, la langue des oiseaux…
Silvia Costa : Cela fait partie de l'œuvre. Au fil de l’opéra, les voix se font de plus en plus chorales, les solistes disparaissent et se fondent dans la communauté qui entre dans l’arche et qui est appelée congrégation. Les enfants qui composent le groupe des animaux apparaissent dans une sorte de parade où ils peuvent mélanger leurs cris au Kyrie Eleison. Les langues et les langages se mêlent. Britten avait pour habitude d’organiser des laboratoires avec les enfants : il leur apprenait à reproduire des cris d’animaux à partir de l’imitation de la nature, à produire des sons utilisant des objets quotidiens tels que des couverts ou des tasses de thé. Après le déluge, il y a l’apparition du corbeau et de la colombe. Noé fait appel à eux et à leur vision aérienne pour savoir si le déluge est fini. Britten a choisi de ne pas reproduire les chants d’oiseaux mais de mettre un pur passage musical, que j’ai saisi comme une invitation à la danse. C'était l’occasion de travailler avec ces enfants qui ont une maîtrise du corps qui ne passe pas par la technique, qui sont encore très libres. Ils font les choses à leur façon et je trouve que c’est très beau parce que c’est naturel, originel.
Simon Hatab : Marielle, je crois que les oiseaux sont aussi très importants pour vous. Vous leur avez même consacré un livre : Une pluie d’oiseaux (Éditions Corti, 2022). Que vous a appris leur langue ?
Marielle Macé : Depuis toujours en fait, la langue des oiseaux est une zone-limite, une zone de rencontre entre les langues humaines et les langues animales. En général, dans notre interrogation sur les langues animales, on affirme une distinction tranchée entre la parole humaine et les énoncés des bêtes, auxquelles on reconnaît une capacité à signifier (à envoyer des signaux), mais pas à « parler ». Mais dans le cas des oiseaux, qui sont tellement virtuoses, qui sont capables d’inventions, d’accents, d’imitation, cela a toujours été une difficulté.
Simon Hatab : Dans vos livres, vous vous attachez à donner une voix au vivant, à la nature et aux animaux…
Marielle Macé : Je ne le dirais pas exactement comme ça : nous ne leur donnons pas une voix. Ils en ont déjà une. Ce que nous pouvons, nous, c’est nous servir de nos langues de la manière la plus vivante et la plus accueillante qui soit. Pas pour « faire parler » des êtres réputés « muets », mais pour pouvoir converser avec eux, au-delà des codes, et pour partager avec eux les paysages du sens. C’est le but de la poésie : non pas inventer la voix de ceux qui, en fait, en ont déjà une, mais frôler, accompagner, aller vers, être le plus créatif possible avec notre langue pour constater que les autres existences ne sont pas muettes.
Silvia Costa : Je pense que c’est aussi ce que dit Britten à la fin de L’Arche de Noé. La voix de Dieu se tait. Alors les rescapés du déluge apprennent à écouter le silence qui est la musique du ciel. C’est comme si, pour trouver notre juste manière d’être au monde, nous autres êtres humains devions apprendre à l’écouter.
Informations sur l’événement
Soutenir l'Opéra
Engagez-vous et contribuez à la concrétisation de ses missions et de ses projets